jeudi 31 mars 2011
Paul Nizon, "Je"
1er janvier 1972, Zurich
Réunis à quelques-uns pour fêter la Saint-Sylvestre chez Peter Keckeis, il est question des mafiosi qui font la loi dans le Tessin. Ça ferait un sujet, dit quelqu’un. Pourquoi un écrivain suisse ne s’empare-t-il donc pas de ça ? Pourquoi nos auteurs ne traitent-ils plus les sujets d’actualité ?
Premier argument de défense. C’est du matériau de magazine, tout juste bon pour un roman documentaire ou un reportage. Je ne peux quand même pas prendre n’importe quel sujet, qu’il relève ou non de mon monde poétique. Ai-je seulement le choix ? Mais, avec votre monde poétique, objecte l’autre, vous finirez peut-être enfermé dans une tour d’ivoire. Raffael Ganz, par exemple, a pris une histoire de travailleurs immigrés et en a tiré quelque chose. Et d’une façon générale, m’entends-je dire, tous les livres des grands auteurs, ou en tout cas beaucoup (Tolstoï : Guerre et Paix, Flaubert : Madame Bovary, Zola…), sont pleins de sujets contemporains. Ne pas se borner à "regarder son nombril", comme dirait Farner, qui fait volontiers ce reproche de nombrilisme aux sujets privés, aux mondes privés des poètes, à leurs choses "intérieures". […]
Qu’ai-je donc, dans le principe, contre cette méthode ou cette manière à la Digglemann ? contre l’idée qu’un homme s’empare d’un thème "public" et le soumette, comme on dit, à sa liberté poétique ? Est-ce méfiance pour la littérature à programme, pour la construction, voire pour l’"invention" ? Une objection artistique ? Je voudrais dans mes récits, ne faire dire que "je". Wolfe. Mais pour l’amour de Dieu, pas d’art appliqué, pas de construction. Surtout pas. D’autre part je n’ai rien, dans le fond, contre quelqu’un comme Per Olof Sundman, qui dans tous ses romans, dans L’Enquête, dans L’Expédition, même dans Le voyage de l’ingénieur Andrée, part de ce genre de constructions ou d’inventions. Il y a un peu de ça aussi dans Cœur de lièvre d’Updike, et tout compte fait chez Mailer aussi, dans certains livres. Dieu sait combien j’aimerais conquérir, dans mes récits, le vaste océan de notre quotidien actuel. Mais plutôt à la façon d’un Saul Bellow (que je n’apprécie pas particulièrement, cela dit). J’aime son art d’évoluer avec le plus grand naturel dans un banal aujourd’hui (le même aujourd’hui que diffuse et orchestre en permanence l’encre noire de la presse quotidienne).
Bien sûr, je payerais cher pour pouvoir m’évader hors de la "littérature" et atteindre la "réalité", j’entends la consignation écrite de notre réalité, une consignation qui la suggérerait à l’état encore brut, de manière directe et émotionnellement parlante. Question d’optique. Dans ce quotidien qui est le mien, quelle réalité prendre en compte et mettre sur le papier ?
Telle est la question qui m’occupe en ce moment. Ne pas me retirer dans une province poétique, mais piquer une tête dans la réalité…
M’engager sur un terrain nouveau, donc. Je voudrais en ce moment pouvoir écrire comme Saul Bellow (en mieux). Je pense à une écriture grandiose et rigoureuse de diariste, libre, sauvage, tendre, personnelle mais imprégnée par l’époque. Ce serait donc quand même un récit où je dirais "je", un récit non fictif, dans la famille des Céline, Miller, Wolfe, mais aussi de Svevo et de Robert Walser ? Toujours sans construction.
6 mars 1972, Zurich
Je bute en ce moment sur une certaine difficulté : jusqu’ici, je n’ai jamais utilisé que de l’autobiographique, du vécu. J’ai dédaigné et refusé l’invention. Ce point de vue subjectif sur mon monde privé (que j’ai laissé derrière moi), j’en ai usé et abusé, dans la Maison, en élevant la maison au rang de métaphore de l’escroquerie sur la vie. […]
Je pense à me défaire des matériaux purement personnels (passés) et à m’embarquer (à contre-cœur*) dans l’invention, la fable et la fiction. […]
C’est à cette croisée des chemins que je me trouve en ce moment. […]
[…]
Chez les Allemands de la plus jeune génération, la critique du langage ou de la parodie des lieux communs, qui dénonce les normes linguistiques et la vie stéréotypée qui va avec, sont aussi une manœuvre d’évitement visant à contourner l’invention et la fiction, en particulier l’action. Mais qu’en est-il de Thomas Bernhard ? Chez lui, ce sont de grands monologues qui évoquent certes, accessoirement, quelques bribes d’action, mais l’action en reste quand même au stade de l’encerclement théorique.
Pour sortir de ma fixation sur mon passé, il faudrait donc que je m’arrache bon gré, mal gré au "je" pour passer à des thèmes objectifs, c’est-à-dire inventés, et les "manipuler". Bon sang, mais qu’est-ce qui me gêne à ce point dans cette idée, qu’elle me soit suggérée par d’autres ou par moi-même ? Eh bien, j’ai très clairement peur de m’"appauvrir". Disons : j’ai peur de devoir sacrifier ma seule propriété, mon monde intérieur.
Et que serait donc ce "monde interne", ce "monde intime" ?
C’est bien sûr avant tout le monde beau, le monde terriblement excitant et riche des trésors de l’enfance ; le monde des sensations et des sentiments, ensuite, sentiment de la nature, visions de voyage, lointains, pressentiment, Eros et autres choses du même tonneau. Le peu de SOI-MÊME que l’on porte avec soi comme un coussin.
Ce bien-là, je crains de le perdre ou du moins de devoir y renoncer en sortant de moi-même pour me faire le chroniqueur de thèmes objectifs. Je crains de couper un cordon ombilical. […]
A quoi craignons-nous de renoncer, que craignons-nous de perdre en quittant l’intériorité ? Avons-nous peur de tomber dans la tristesse, dans l’exil ? […]
Paul Nizon, in Les premières éditions des sentiments, Journal 1961-1972.
* En français dans le texte original.
(A suivre... un "je", autre)
Libellés :
Littérature,
Paul Nizon,
Saint Sylvestre
mercredi 30 mars 2011
Sincèrement vôtre
Madame la Chesnay dans La règle du jeu :
« Les gens sincères sont ennuyeux ».
Cette phrase m’a touché en plein cœur.
Un de mes fidèles lecteur m’écrit pour savoir ce que j’ai voulu dire. Explications sommaires.
Cette phrase m’a « touchée » dans le sens : m’a atteinte.
Je ne pensais pas à l’Amour, aux relations amoureuses.
Je pensais à ma sincérité et donc à cette image sans doute ennuyeuse que je devais projeter. Ça pèse lourd la sincérité, ce n’est pas du tout léger. On prend des risques.
Pour moi il n’existe pas de relations vraies, amicales sans sincérité. Je mets à part les relations professionnelles où là, comme en politique, la sincérité n’existe pas !
Je considère que la sincérité est une vertu et qu’il n’y a pas de sincérité sans loyauté.
Voilà ce que je voulais dire.
"La sincérité est l'expression fidèle des sentiments réels, par la vérité. La sincérité peut être vue comme une vertu philosophique ou comme un risque pratique."
"Dans la tradition confucéenne, la sincérité (qu'on peut aussi traduire par honnêteté ou fidélité, chinois : chéng 誠 ; japonais : makoto 誠) est une vertu de clarté et de transparence dans les relations sociales."
"Le plus dur des combats que j’ai mené contre mon âme est lorsque j’ai voulu l’obliger à être sincère." Source : Majmû’ Fatâwâ wa Rasâ’il Shaykh Ibn ‘Uthaymîn, (1/98-100)
"Aristote donne son analyse de la sincérité : Est sincère l'homme "qui reconnaît l’existence de ses qualités propres, sans y rien ajouter ni retrancher.".[…] Il indique que la sincérité est une vertu noble, et que son contraire est méprisable."
"D'après Kant, la sincérité est un impératif. Il récuse tout droit au mensonge."
(Sources : Wikipédia)
J'ai déjà parlé dans ce journal de ma sincérité, de mon manque de diplomatie. Il m'est arrivé de mentir, par omission, parce que, auparavant, ma sincérité avait été mal perçue. C'est en cela sans doute, que les gens sincères peuvent paraître ennuyeux.
« Les gens sincères sont ennuyeux ».
Cette phrase m’a touché en plein cœur.
Un de mes fidèles lecteur m’écrit pour savoir ce que j’ai voulu dire. Explications sommaires.
Cette phrase m’a « touchée » dans le sens : m’a atteinte.
Je ne pensais pas à l’Amour, aux relations amoureuses.
Je pensais à ma sincérité et donc à cette image sans doute ennuyeuse que je devais projeter. Ça pèse lourd la sincérité, ce n’est pas du tout léger. On prend des risques.
Pour moi il n’existe pas de relations vraies, amicales sans sincérité. Je mets à part les relations professionnelles où là, comme en politique, la sincérité n’existe pas !
Je considère que la sincérité est une vertu et qu’il n’y a pas de sincérité sans loyauté.
Voilà ce que je voulais dire.
"La sincérité est l'expression fidèle des sentiments réels, par la vérité. La sincérité peut être vue comme une vertu philosophique ou comme un risque pratique."
"Dans la tradition confucéenne, la sincérité (qu'on peut aussi traduire par honnêteté ou fidélité, chinois : chéng 誠 ; japonais : makoto 誠) est une vertu de clarté et de transparence dans les relations sociales."
"Le plus dur des combats que j’ai mené contre mon âme est lorsque j’ai voulu l’obliger à être sincère." Source : Majmû’ Fatâwâ wa Rasâ’il Shaykh Ibn ‘Uthaymîn, (1/98-100)
"Aristote donne son analyse de la sincérité : Est sincère l'homme "qui reconnaît l’existence de ses qualités propres, sans y rien ajouter ni retrancher.".[…] Il indique que la sincérité est une vertu noble, et que son contraire est méprisable."
"D'après Kant, la sincérité est un impératif. Il récuse tout droit au mensonge."
(Sources : Wikipédia)
J'ai déjà parlé dans ce journal de ma sincérité, de mon manque de diplomatie. Il m'est arrivé de mentir, par omission, parce que, auparavant, ma sincérité avait été mal perçue. C'est en cela sans doute, que les gens sincères peuvent paraître ennuyeux.
Je ne parlerai, je ne penserai à rien
A mesure qu’on s’élève dans le ciel, on s’enfonce dans la tristesse.
Pour palier à cet état de mon âme ce matin,
"je ne parlerai pas, je ne penserai à rien".
Sensation
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l'amour infini me montera dans l'âme,
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, - heureux comme avec une femme.
Mars 1870.
Arthur Rimbaud
(Ce texte était joint à la lettre de Rimbaud à Théodore de Banville du 24 mai 1870.)
Charleville (Ardennes), le 24 mai 1870.
À Monsieur Théodore de Banville.
Cher Maître,
Nous sommes aux mois d'amour ; j'ai dix-sept ans. L'âge des espérances et des chimères, comme on dit, - et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la Muse, - pardon si c'est banal, - à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes - moi j'appelle cela du printemps.
Que si je vous envoie quelques-uns de ces vers, - et cela en passant par Alph. Lemerre, le bon éditeur, - c'est que j'aime tous les poètes, tous les bons Parnassiens, - puisque le poète est un Parnassien, - épris de la beauté idéale ; c'est que j'aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai romantique, un vrai poète. Voilà pourquoi, - c'est bête, n'est-ce pas, mais enfin ?
Dans deux ans, dans un an peut-être, n'est-ce pas, je serai à Paris. - Anch'io, messieurs du journal, je serai Parnassien ! - Je ne sais ce que j'ai là... qui veut monter... - Je jure, cher maître, d'adorer toujours les deux déesses, Muse et Liberté.
Ne faites pas trop la moue en lisant ces vers... Vous me rendriez fou de joie et d'espérance, si vous vouliez, cher Maître, faire faire à la pièce Credo in unam une petite place entre les Parnassiens... Je viendrais à la dernière série du Parnasse : cela ferait le Credo des poètes !... - Ambition ! Ô Folle !
Arthur Rimbaud
Pour palier à cet état de mon âme ce matin,
"je ne parlerai pas, je ne penserai à rien".
Sensation
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l'amour infini me montera dans l'âme,
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, - heureux comme avec une femme.
Mars 1870.
Arthur Rimbaud
(Ce texte était joint à la lettre de Rimbaud à Théodore de Banville du 24 mai 1870.)
Charleville (Ardennes), le 24 mai 1870.
À Monsieur Théodore de Banville.
Cher Maître,
Nous sommes aux mois d'amour ; j'ai dix-sept ans. L'âge des espérances et des chimères, comme on dit, - et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la Muse, - pardon si c'est banal, - à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes - moi j'appelle cela du printemps.
Que si je vous envoie quelques-uns de ces vers, - et cela en passant par Alph. Lemerre, le bon éditeur, - c'est que j'aime tous les poètes, tous les bons Parnassiens, - puisque le poète est un Parnassien, - épris de la beauté idéale ; c'est que j'aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai romantique, un vrai poète. Voilà pourquoi, - c'est bête, n'est-ce pas, mais enfin ?
Dans deux ans, dans un an peut-être, n'est-ce pas, je serai à Paris. - Anch'io, messieurs du journal, je serai Parnassien ! - Je ne sais ce que j'ai là... qui veut monter... - Je jure, cher maître, d'adorer toujours les deux déesses, Muse et Liberté.
Ne faites pas trop la moue en lisant ces vers... Vous me rendriez fou de joie et d'espérance, si vous vouliez, cher Maître, faire faire à la pièce Credo in unam une petite place entre les Parnassiens... Je viendrais à la dernière série du Parnasse : cela ferait le Credo des poètes !... - Ambition ! Ô Folle !
Arthur Rimbaud
mardi 29 mars 2011
En avant la zutique
Je n’avais jamais vu La règle du jeu, le film de Renoir.
Je l’ai regardé hier soir. Une lacune comblée.
Jean Renoir n’épargne rien dan ce film : la morale est bien égratignée.
C’est un film terrible, éblouissant, dans sa violence sur cette société de la haute bourgeoisie.
"Dans la France des années 30, des membres de la haute société, réunis pour une partie de chasse en Sologne, se jouent une comédie des sentiments qui se résout tragiquement. Conçu pour être l'événement cinématographique de l'année 1939, La Règle du jeu se heurta à l'incompréhension du public qui n'en vit à l'époque qu'une version tronquée. Redécouvert vingt ans plus tard grâce à sa restauration intégrale, ce film est depuis salué comme le chef-d'oeuvre de Jean Renoir, une date dans l'histoire du cinéma, et même, pour reprendre le mot de François Truffaut, comme " le film des films "."
"Je voulais faire un film agréable, mais qui soit en même temps une critique d'une société que je considérais comme résolument pourrie "dixit l’auteur...
Madame la Chesnay (Christine) : "Les gens sincères sont ennuyeux".
Cette phrase m’a touché en plein cœur.
Cœurs sensibles, cœurs fidèles,
Qui blâmez l’amour léger,
Cessez vos plaintes cruelles :
Est-ce un crime de changer ?
Si l’Amour porte des ailes,
N’est-ce pas pour voltiger ?
N’est-ce pas pour voltiger ?
N’est-ce pas pour voltiger ?
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, Acte IV. Scène X. (En exergue dans le générique du film).
Ce matin j’écoute les NCC : Verlaine et Rimbaud (ci-dessus au coin à gauche). Invité de l’émission, Bernard Teyssèdre auteur de Arthur Rimbaud et le foutoir zutique, éditions Léo Scherr 2011.
Et si ce n’était dit avec la voix si précieuse et élégante de Raphaël Enthoven, le poème L’Idole, les textes zutiques auraient de quoi "offusquer le bourgeois".
Parodie, obscénité, homosexualité ?
"Le trou du cul n’est pas l’apanage de l’homosexualité que je sache" dixit R. Enthoven.
En cours d’émission Raphaël Enthoven précise qu’il s’agit d’une émission très sérieuse. Nous en douterions ?
Après cette soirée avec Jean Renoir et cette matinée avec Verlaine et Rimbaud, je me demande bien ce que je pourrai faire aujourd’hui.
Un vent de liberté souffle dans… mon cœur.
lundi 28 mars 2011
Paul Nizon, Londres
"Les couleurs à l'huile"
5 octobre 1968, Londres
J’aime cette ville avec une tendre intensité, avec gratitude, avec émoi. Je la regarde, c’est-à-dire que je regarde au-dehors – dans n’importe quelle direction, et je sais que l’œil reviendra avec quelque chose, comme dans un rêve. L’œil rapporte du dehors un doux enchantement, une vision intérieure. C’est ça qui est merveilleux.
La vie est si éloignée, assourdie, diffractée par je ne sais quel souple et trouble prisme, qu’elle ne parvient pas à l’œil externe mais à l’œil interne. Ce brun noirâtre de la brique, jouant à se changer en lilas rougeâtre. Est-ce une immatérialité ? C’est de la poussière, une chose qui s’émiette, qui s’en va en morceaux. Mais des morceaux très fins, presque réduits en poudre. Nulle plasticité (qualité que j’aime tant), toujours et partout cette grande pulvérulence, le désert… Et quelque chose de diffracté et de laiteux. L’image (rebattue) du brouillard anglais a quand même une part de vérité. Un brouillard ou une atomisation, une infinité de particules. Mais même dans le SILENCE il y a une sorte de gentillesse, de bienveillance touchante ! Ainsi les encadrements de fenêtres, tant dans leurs proportions que dans leur peinture, les silhouettes fantastiques des maisons, les magasins, les couleurs à l’huile, au fond la monstruosité du goût dans ce qu’il a justement de non prétentieux, de bricolé, ou au contraire d’appliqué, produisent une beauté chaleureuse, saisissante d’humanité. Comme les filles. Comme le transbordement des passagers dans l’Underground.
Le gris du quotidien a ici quelque chose de vivant, de poétique au possible, il respire le respect de l’autre, le tact, la finesse, la LIBERTÉ. Je suis amoureux de cette ville, si discrète.
Et l’humanité qu’on perçoit dans tout cet effort libérateur, souvent gauche, toujours plein de tact, suscite une atmosphère générale de "ravissement" qui parle directement au cœur.
La rue – St John’s Hill par exemple ou la Battersea High Street : quelle irréalité ! La largeur de la rue et l’espace vide au milieu. La faible hauteur des bâtiments, ensuite. La diversité de leurs silhouettes, qui sont fantasques et maladroites prises isolément. Mais si belles, pourtant, dans leur juxtaposition de badigeon et de briques noircies. Et, laiteuse, la lumière d’atmosphère.
Vu du train, c’est comme un gigantesque champ de ruines. Mais très vivant et habité au rez-de-chaussée. Et exotique, encore une fois. Un décor et un bric-à-brac de Far West. Et un audacieux lettrisme. Et un audacieux courrier publicitaire à longueur de rue, toutefois recouvert par le brun crépuscule du rêve et du désert, par le noirâtre de la suie.
Les filles ne sont ni arrogantes ni vaniteuses, mais étrangement douces, calmes, aimables, jolies. Le dénudé des minijupes, ici, est comme un trait de camaraderie, plus que de coquetterie ou de provocation. Il n’y a qu’ici qu’on porte la minijupe comme ça. Avec autant d’ "âme"... ?
Une impétueuse excentricité dans les petites choses (en tant qu’expression de la liberté individuelle) – mais, dans les grandes, une uniformité, presque une absence. Une absence au sens mental, un obscurcissement. Avec le temps, cela se communique en profondeur, jusqu’à faire mal.
La réponse est l’amour.
La liberté. Le principe de diversité.
Paul Nizon, in Les premières éditions des sentiments, Journal 1961-1972, éditions Actes Sud 1992.
Battersea High Street
dimanche 27 mars 2011
Paul Nizon, Zurich
(Chocolat Kohler, souvenir d'enfance,
nous collectionnions les images Les Merveilles du Monde)
Zurich, été 1968
Promenade mentale à travers la ville (Zurich)
En m’engageant dans ma ruelle je suis enténébré par des maisons dont la pierre de taille, marquée de cicatrices, me serre de près. Aux fraîches ténèbres qui m’engloutissent s’ajoute un certain vertige dû aux murs de guingois, au pavé bosselé ; une vague de vapeur pierreuse. Après ce goulot, la ruelle s’ouvre sur une petite place avec une fontaine, un arbre et des escaliers qui mènent à la rivière.
[…]
"Je vais en ville" dit-on chez nous, et c’est comme si on partait en voyage ou en expédition. Où est donc la ville ? Précisément dans le noyau urbain, dans le centre – dans la ville d’autrefois. Hors de ce noyau central, ce n’est manifestement pas la ville.
Dans la très grande majorité des villes suisses, le citadin ne peut choisir qu’entre deux solutions : la "ville" vivante, pétillante, pleine de sève, et la zone morte des quartiers-dortoirs, des "quartiers pénitentiaires". Le centre, le centre urbain, correspond à la vieille ville, à la ville intérieure, produit des temps passés qui a été, un peu comme une city, meublé, garni, élargi ou noyauté.
Berne en est un bon exemple. Berne, dans sa disposition, est assurément une ville, mais c’est une citadelle, une ville fortifiée du Moyen Age. Berne consiste en une vieille ville, lourde comme la pierre – elle va de la gare jusqu’à la Fosse-aux-Ours -, avec des arcades, des fontaines, des portes, mais peu de places. Berne est un monument. C’est ce que ressentent les étrangers quand ils découvrent sa plastique depuis le Rosengarten, et ils la louent haut et fort quand ils s’amassent autour de la tour de l’Horloge.
A Zurich, c’est déjà mieux. Je suis loin de me sentir banni quand je quitte le centre. Zurich comporte plusieurs secteurs urbains, a "de la ville en stock", bien avant que commencent les ceintures d’exil.
J’ai vécu dans plusieurs quartiers de ce genre, et je n’ai jamais eu l’impression d’être mis à l’écart. Au Seefeld par exemple.
Le Seefeld, au fond, est un quartier qui tient de la station balnéaire à l’ancienne, mais aussi du parc – et du complexe de plaisance avec hôtels, pensions, villas -, et qui avec le temps, sans doute insensiblement, a été rattrapé et noyauté par la "ville". Mais l’atmosphère de parc, de villas et de détente y reste encore partout perceptible.
[…]
Et puis la VILLE a atteint et dépassé ces sanctuaires de jadis, avec tout le vacarme des voitures et des trams, avec les magasins, l’affairement, les sous-locations. Peu à peu ces résidences se vident, certaines, par suite de banqueroutes ou faute de personnel, ne peuvent plus être entretenues, changent de mains et se retrouvent à remplir une pure fonction d’apparat. D’autres se délabrent, toutes prennent de la patine, et soudain le jardin d’EDEN jouxte le vacarme du centre.
Une ville vivante, une ville où la vie vaille la peine d’être vécue doit scintiller, posséder toutes sortes de paysages urbains. Elle doit porter en elle l’autre, l’étranger. Elle doit par exemple, comme le 4e arrondissement de Zurich, avoir un quartier italien à elle avec ses vingt – ou cinquante ? – bars, restaurants, pizzerias, bistrots et cantines cent pour cent italiens dans un mouchoir de poche ; avec l’incomparable langue lumineuse de "Longstreet" la nuit ; avec une activité commerciale plus visible dans et devant les boutiques souvent miteuses de tissus, de chaussures et de linge, les brocantes, les magasins de bouffe, le commerce de rue proprement dit. Ici les enseignes sont en italien, les cinémas ont des programmes populaires comme dans le Sud, ici l’on a ses fanfares à soi qui défilent, ses malheurs et ses crimes bien à soi.
Pourquoi les vieilles villes et les quartiers du XIXe siècle vieillissent-ils bien, malgré les atteintes du temps ? Parce qu’à l’époque régnait une idée de la ville qui entendait prendre en compte et satisfaire toutes les conditions de vie imaginables, et, en plus ou à cause de ça, exprimer son époque ou annoncer l’avenir.
[…] Un alignement de casernes-dortoirs, sans autre attrait ni fonction, n’embellit pas avec l’âge.
Partant de l’architecture, on pourrait ainsi comprendre notre mentalité :
La ville, nous l’avons, elle est historiquement signifiante, esthétiquement reconnue, attirante touristiquement – alors, à quoi bon une ville nouvelle ?
La ville doit rester comme elle est. C’est pourquoi il n’est jamais question que d’entretien et de préservation, afin que rien ne change (au tableau) et qu’aucun ajout ne vienne déranger (sa silhouette).
Paul Nizon, in Les premières éditions des sentiments, Journal 1961-1972, éditions Actes Sud 2006.
Nizon parle beaucoup de la Ville dans ce journal et de la Maison. Il est alors en train d’écrire Dans la maison, les histoires se défont qui sera publié en langue allemande en 1971 et chez Actes Sud pour la traduction en 1992.
Quelques photos de Seefeld dont parle Nizon :
Hôtel Eden au lac, Seefeld, Zurich
Sculpture "Heureka" de Jean Tinguely 1964, Seefeld, Zurich
Paul Nizon, rappel ici et là.
C'est la première fois que je vois des photos de Zurich. J'imaginais une ville sombre, grise. Pourquoi? Je n'en sais rien. En découvrant ces images, je n'ai plus aucune envie d'aller à Zurich pour mourir! Non mais!
vendredi 25 mars 2011
Souvenirs...
10 h 30.
Un ami me relate son mariage, je lui réponds en relatant le mien. Je souris en le faisant, je nous revois nous passant la bague au doigt à la cérémonie, ton beau sourire…
C’est étrange, je parle toujours de toi sans tristesse, sans regrets. Tu m’as tant donné. Je n’avais plus rien à attendre. J’étais assouvie. C’est pour cela que j’ai pu donner et recevoir après toi.
11 h. Un petit café, c’est l’heure.
Concerto pour l’empereur, deuxième mouvement, c’est le premier morceau qu’un ami m’avait gravé sur ce CD.
Il connaissait mes goûts, nous avions les mêmes. C’était il y a dix ans.
Nous nous sommes perdus de vue, il me reste tous ces CD gravés pour moi, ses dessins posés sur les étagères de ma bibliothèque et les souvenirs, les bons et les mauvais. On oublie les mauvais quand les bons furent plus nombreux. J’aime que les hommes que j’ai aimés me laissent des souvenirs. Je garde tout, même lorsque l’amour s’est éteint, à l’intérieur, il reste toujours une petite flamme.
Ensuite, sur ce même CD :
. Gorecky, Symphony No. 3 "Sorrowful Songs"
. Puccini, Madame Butterfly
. Poulenc, sonate pour hautbois et piano
. Ravel, concerto pour piano, deuxième mouvement
. Ravel, Pavane
. Marc-Antoine Charpentier, Leçon des ténèbres
. Bach, Passion selon Saint Matthieu
Pendant quelques minutes je ne pense plus à rien.
J’écoute en sirotant mon café.
Je regarde le ciel par la fenêtre.
Il fait affreusement beau.
Bien-être.
Je voudrai mourir là, maintenant.
Un ami me relate son mariage, je lui réponds en relatant le mien. Je souris en le faisant, je nous revois nous passant la bague au doigt à la cérémonie, ton beau sourire…
C’est étrange, je parle toujours de toi sans tristesse, sans regrets. Tu m’as tant donné. Je n’avais plus rien à attendre. J’étais assouvie. C’est pour cela que j’ai pu donner et recevoir après toi.
11 h. Un petit café, c’est l’heure.
Concerto pour l’empereur, deuxième mouvement, c’est le premier morceau qu’un ami m’avait gravé sur ce CD.
Il connaissait mes goûts, nous avions les mêmes. C’était il y a dix ans.
Nous nous sommes perdus de vue, il me reste tous ces CD gravés pour moi, ses dessins posés sur les étagères de ma bibliothèque et les souvenirs, les bons et les mauvais. On oublie les mauvais quand les bons furent plus nombreux. J’aime que les hommes que j’ai aimés me laissent des souvenirs. Je garde tout, même lorsque l’amour s’est éteint, à l’intérieur, il reste toujours une petite flamme.
Ensuite, sur ce même CD :
. Gorecky, Symphony No. 3 "Sorrowful Songs"
. Puccini, Madame Butterfly
. Poulenc, sonate pour hautbois et piano
. Ravel, concerto pour piano, deuxième mouvement
. Ravel, Pavane
. Marc-Antoine Charpentier, Leçon des ténèbres
. Bach, Passion selon Saint Matthieu
Pendant quelques minutes je ne pense plus à rien.
J’écoute en sirotant mon café.
Je regarde le ciel par la fenêtre.
Il fait affreusement beau.
Bien-être.
Je voudrai mourir là, maintenant.
mercredi 23 mars 2011
De l'amitié
Dans la dernière émission des NCC consacrée à Montaigne, j’ai entendu cette phrase que nous connaissons tous, si belle, si rare :
"Parce que c’était lui, parce que c’était moi"
"C'est après la mort de son ami que Montaigne a écrit les Essais un magnifique travail de deuil.
"Cette amitié (...) que Dieu a voulu entre nous si entière et si parfaite que c'est beaucoup si la fortune y arrive une fois en trois siècles".
Cette amitié parfaite dont parle Montaigne dans les Essais, c'est celle qui l'unit à La Boétie. Une amitié qui dura peu — à peine cinq ans — mais qui fut si entière que seule la mort prématurée de La Boétie, en 1563, devait l'interrompre.
Tout laisse à penser que Montaigne ne se remet pas de cette mort. Et nombre de critiques, comme André Comte-Sponville, pensent que les Essais ne sont rien d'autre qu'un magnifique travail de deuil : "Regardez le ton des Essais, il est mélancolique au début, puis gai, léger, aérien à la fin. Un peu comme si l'oeuvre de Montaigne était le tombeau de La Boétie".
D'où ces nombreux sonnets de La Boétie qui parsèment le texte, comme si le Moi de Montaigne qui s'expose — "je suis moi-même la matière de mon livre" devait nécessairement mêler cet autre lui-même que fut l'ami disparu.
D'où surtout l'hymne à l'amitié où Montaigne évoque cette relation sans pareil. Incomparable, dit-il, aux liens qui unissent un père à ses enfants — où la communication ne saurait être franche et directe —, ou à ceux qui existent entre frères — souvent minés par la rivalité -, ou encore aux liens familiaux en général où le choix n'a pas de part. Sans commune mesure avec "l'affection envers les femmes" — où le désir meurt comme la jouissance du corps s'assouvit tandis que celui de l'amitié s'élève et s'affine à l'usage— ni avec l'homosexualité — il fustige l'amitié des Grecs anciens esclaves de la beauté externe. Différente aussi des simples relations — "accointances" — que l'on confond trop souvent avec l'amitié véritable. Les premières, dit l'auteur des Essais, permettent de ne pas s'ennuyer — "Les âmes s'entretiennent" - tandis qu'il est question d'une véritable fusion des esprits dans la deuxième."
Le Nouvel Observateur, Véronique Maumusson.
Bref, l'amitié est une Grâce qui lui fait parler de sa première rencontre avec La Boétie comme d'un coup de foudre — "nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre" — et de leur relation comme d'un éblouissement où vinrent se perdre leurs deux volontés — "je dis perdre, à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre, ni qui fut sien, ou mien" .
Une Grâce qui laisse l'écrivain sans mots : "Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer, qu'en répondant : Parce que c'était lui, parce que c'était moi". Quand l'amitié véritable ressemble à l'amour....
Extrait :
Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant : "Parce que c'était lui, parce que c'était moi".
Il y a, au-delà de tout mon discours, et de ce que j'en puis dire particulièrement, je ne sais quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous être vus, et par des rapports que nous entendions l'un de l'autre, qui faisaient en notre affection plus d'effort que ne porte la raison des rapports, je crois par quelque ordonnance du ciel; nous nous embrassions par nos noms. Et à notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre. Il écrivit une satyre latine excellente, qui est publiée, par laquelle il excuse et explique la précipitation de notre intelligence, si promptement parvenue à sa perfection. Ayant si peu à durer, et ayant si tard commencé (car nous étions tous deux hommes faits, et lui de quelques années de plus), elle n'avait point à perdre de temps et à se régler au patron des amitiés molles et régulières, auxquelles il faut tant de précautions de longue et préalable conversation. Celle-ci n'a point d'autre idée que d'elle-même, et ne se peut rapporter qu'à soi. Ce n'est pas une spéciale considération, ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille : c'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange, qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena se plonger et se perdre dans la sienne; qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena se plonger et se perdre en la mienne, d'une faim, d'une concurrence pareille. Je dis perdre, à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien, ou mien.
Montaigne, Essais (I, XXVIII) : De l'amitié.
"Parce que c’était lui, parce que c’était moi"
"C'est après la mort de son ami que Montaigne a écrit les Essais un magnifique travail de deuil.
"Cette amitié (...) que Dieu a voulu entre nous si entière et si parfaite que c'est beaucoup si la fortune y arrive une fois en trois siècles".
Cette amitié parfaite dont parle Montaigne dans les Essais, c'est celle qui l'unit à La Boétie. Une amitié qui dura peu — à peine cinq ans — mais qui fut si entière que seule la mort prématurée de La Boétie, en 1563, devait l'interrompre.
Tout laisse à penser que Montaigne ne se remet pas de cette mort. Et nombre de critiques, comme André Comte-Sponville, pensent que les Essais ne sont rien d'autre qu'un magnifique travail de deuil : "Regardez le ton des Essais, il est mélancolique au début, puis gai, léger, aérien à la fin. Un peu comme si l'oeuvre de Montaigne était le tombeau de La Boétie".
D'où ces nombreux sonnets de La Boétie qui parsèment le texte, comme si le Moi de Montaigne qui s'expose — "je suis moi-même la matière de mon livre" devait nécessairement mêler cet autre lui-même que fut l'ami disparu.
D'où surtout l'hymne à l'amitié où Montaigne évoque cette relation sans pareil. Incomparable, dit-il, aux liens qui unissent un père à ses enfants — où la communication ne saurait être franche et directe —, ou à ceux qui existent entre frères — souvent minés par la rivalité -, ou encore aux liens familiaux en général où le choix n'a pas de part. Sans commune mesure avec "l'affection envers les femmes" — où le désir meurt comme la jouissance du corps s'assouvit tandis que celui de l'amitié s'élève et s'affine à l'usage— ni avec l'homosexualité — il fustige l'amitié des Grecs anciens esclaves de la beauté externe. Différente aussi des simples relations — "accointances" — que l'on confond trop souvent avec l'amitié véritable. Les premières, dit l'auteur des Essais, permettent de ne pas s'ennuyer — "Les âmes s'entretiennent" - tandis qu'il est question d'une véritable fusion des esprits dans la deuxième."
Le Nouvel Observateur, Véronique Maumusson.
Bref, l'amitié est une Grâce qui lui fait parler de sa première rencontre avec La Boétie comme d'un coup de foudre — "nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre" — et de leur relation comme d'un éblouissement où vinrent se perdre leurs deux volontés — "je dis perdre, à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre, ni qui fut sien, ou mien" .
Une Grâce qui laisse l'écrivain sans mots : "Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer, qu'en répondant : Parce que c'était lui, parce que c'était moi". Quand l'amitié véritable ressemble à l'amour....
Extrait :
Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant : "Parce que c'était lui, parce que c'était moi".
Il y a, au-delà de tout mon discours, et de ce que j'en puis dire particulièrement, je ne sais quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous être vus, et par des rapports que nous entendions l'un de l'autre, qui faisaient en notre affection plus d'effort que ne porte la raison des rapports, je crois par quelque ordonnance du ciel; nous nous embrassions par nos noms. Et à notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre. Il écrivit une satyre latine excellente, qui est publiée, par laquelle il excuse et explique la précipitation de notre intelligence, si promptement parvenue à sa perfection. Ayant si peu à durer, et ayant si tard commencé (car nous étions tous deux hommes faits, et lui de quelques années de plus), elle n'avait point à perdre de temps et à se régler au patron des amitiés molles et régulières, auxquelles il faut tant de précautions de longue et préalable conversation. Celle-ci n'a point d'autre idée que d'elle-même, et ne se peut rapporter qu'à soi. Ce n'est pas une spéciale considération, ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille : c'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange, qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena se plonger et se perdre dans la sienne; qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena se plonger et se perdre en la mienne, d'une faim, d'une concurrence pareille. Je dis perdre, à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien, ou mien.
Montaigne, Essais (I, XXVIII) : De l'amitié.
Clin d'oeil dans la vitrine
Photos du jour!
"... une des choses les plus tristes, chez l'homme, c'est sa manière de vieillir... " Edward Franklin Albee, in Who’s Afraid of Virginia Woolf?, 1962.
Elizabeth Taylor est morte (1932-2011).
mardi 22 mars 2011
Printemps
Il y a des jours où les mots seraient si désespérés que les images les remplacent avantageusement. Du moins sont-elles plus douces et source d'espérance.
Le printemps est bien là.





23 h.
Je rentre du théâtre : Elle sera mieux dans mon rodhodendron!Coccinelle dans ma cuisine cet après-midi!
Cette pie m'a suivie hier pendant dix minutes!
Elle avait des ailes d'un joli bleu.Le mystère du bouquet de roses.
D'excellentes comédiennes. De très jolis moments, de longs moments aussi!
lundi 21 mars 2011
Guy de Cointet, performance (suite)
Je disais hier :
"Mercredi soir j’ai donc assisté à une performance de Dominique Gilliot. Elle a investi le Centre d’Art Contemporain avec une performance sonorisée, déambulatoire, incluant des chansons décalées, des actions millimétrées, des poésies miniatures, en relation avec l’exposition Guy de Cointet. Humour et dérision, j’ai trouvé la "performeuse" intéressante." Etonnante!
Voici donc quelques photos et deux petites vidéos de l'artiste en action.
"Mercredi soir j’ai donc assisté à une performance de Dominique Gilliot. Elle a investi le Centre d’Art Contemporain avec une performance sonorisée, déambulatoire, incluant des chansons décalées, des actions millimétrées, des poésies miniatures, en relation avec l’exposition Guy de Cointet. Humour et dérision, j’ai trouvé la "performeuse" intéressante." Etonnante!
Voici donc quelques photos et deux petites vidéos de l'artiste en action.
Libellés :
Art,
CAC Quimper,
Exposition,
Guy de Cointet
dimanche 20 mars 2011
Guy de Cointet

 Guy de Cointet et Mary Ann Duganne, actrice "performeuse"
Guy de Cointet et Mary Ann Duganne, actrice "performeuse""Guy de Cointet [1934-1983] (il a vécu le même nombre d’années que toi) quitte la France pour New York en 1965 où il fréquente la Factory d'Andy Warhol puis devient l’assistant du sculpteur minimaliste Larry Bell à Los Angeles. Influencé par Raymond Roussel, il écrit plus d’une vingtaine de pièces performatives figurant des accessoires scéniques qui transforment la relation entre les mots, les formes et les couleurs.
Des années 70 jusqu’à son décès en 1983, Guy de Cointet réalise des dessins étranges, parfois dépouillés et très souvent biscornus, où la main joue des tours singuliers à des déclarations triviales ou à des aphorismes cabalistiques. Si les textes de Cointet trouvent un point d’accomplissement dans leurs performances théâtrales, il n’est point de dessin sans texte ou presque. Et c’est peut-être dans ses dessins que le texte, débarrassé de tout enjeu théâtral, apparaît le plus nettement dans la multiplicité de ses sources. Ici un poème de Rimbaud, un slogan publicitaire ou une note de journal intime, là un message personnel, une bribe de conversation, une illumination ou un fragment de roman de consommation… l’enveloppant au contraire d’une gangue le rendant illisible, les dessins de Cointet sont loin d’être de simples exercices calligraphiques.
Le travail de Guy de Cointet est réapparu en Europe en 1996 au Centre National d’Art Contemporain Le Magasin, à Grenoble, grâce à une invitation faite à l’artiste Paul McCarthy, témoin et ami de Los Angeles. Une rétrospective lui a ensuite été consacrée en 2004 au Mamco (Musée d’Art Moderne et Contemporain) de Genève."
Je me suis donc promenée dans l’exposition, m’attardant sur des dessins, des chiffres, des lettres de l’alphabet, des signes calligraphiques, m’appuyant sur le petit livret que j’avais en main pour tenter d’en comprendre le sens et, surtout, avec le désir d’en savoir plus sur cet artiste au charisme indéniable quand on voit ses photos. Et, cette semaine, j’ai donc picoré ça et là, des renseignements, des textes, qui m’éclaireraient sur son travail.


Voilà ce que je ne dois plus faire : amasser des informations, des documents, des photos, des vidéos pendant une semaine sur un sujet en vue d’en parler ! Quelle folie !
Ce n’est pas un billet qu’il faut faire sur Guy de Cointet (photo ci-dessus), c’est un livre ou un film, ce qui a déjà été fait.
Alors tant pis, je ne me sens pas le courage de parler d’un artiste que je viens de découvrir sans avoir l’impression de ne pas savoir faire ressortir l’essentiel. Son travail est si multiple, si riche, d’où la difficulté d’être concise.
Bon, je commence depuis le début !
Dimanche dernier je suis allée voir une exposition de quelques œuvres de Guy de Cointet au Centre d’Art Contemporain. J’insiste sur : Art Contemporain. Exposition réalisée grâce au concours de la Succession de Cointet et de la galerie Air de Paris ; elle réunit un ensemble de cinquante œuvres sur papier, encres pour la plupart exécutées entre 1971 et 1983, et prêtées par le Musée National d’Art Moderne/Centre Pompidou ainsi que par des collectionneurs privés. Présentation de l’exposition sur France Culture (5 minutes) ici.
Now, I'll go and smoke a cigarette
Now, I'll go and smoke a cigarette
Marie de Brugerolle, in Premières critiques, éd. Les presses du réel & JRP/Ringier.
Guy de Cointet est un artiste performeur ! C’est en assistant à une "performance" mercredi, que j’ai appris ce qu’était un « performeur ».
"L'art performance est une forme d'art dans laquelle les actions d'un individu ou d'un groupe, dans un espace et à un moment particulier constituent l'oeuvre d'art. Ces performances peuvent arriver n'importe où et à tout moment. Le corps, le temps et l'espace constituent généralement les matériaux de base d'une "performance".
L’expérience artistique se fait par l’interaction avec un objet ou un film… C’est le corps de l’artiste qui transforme l’ensemble action plus objets en sculpture. Le temps de l’œuvre est le temps de la co-présence de l’artiste, de choses et des spectateurs." (Wikipédia)
Mercredi soir j’ai donc assisté à une performance de Dominique Gilliot. Elle a investi le Centre d’Art Contemporain avec une performance sonorisée, déambulatoire, incluant des chansons décalées, des actions millimétrées, des poésies miniatures, en relation avec l’exposition Guy de Cointet. Humour et dérision, j’ai trouvé la "performeuse" intéressante. Je mettrai ce soir deux petites vidéos et les photos, Blogger bloque, débloque pour le moment.
Jeudi soir, j’ai suivi la télé-conférence (merci skype) de l’historienne d’art Marie de Brugerolle, en direct de Lyon, passionnante, suivie d’une projection de documents filmés inédits (le film est en cours de réalisation, c'était donc une avant-première, il aura des sous-titres français, parce-que là tout était en anglais, accent américain, mauvais son, je n'ai pas capté la quart de ce qui était dit mais l'historienne nous avait bien résumé ce que nous allions voir)) sur le travail de Guy de Cointet avec le témoignage de Paul McCarthy et Jeffrey Perkins, cinéaste ami de Guy de Cointet.
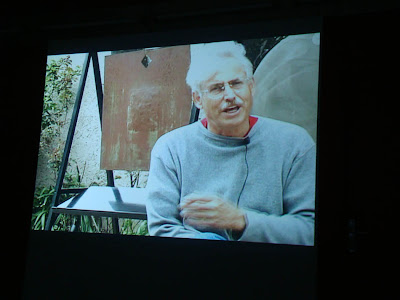
 Paul MacCarthy
Paul MacCarthy
J’ai pendant très longtemps été complètement hermétique à l’art contemporain et depuis que je m’oblige à aller voir ces expositions au CAC de ma ville, peu à peu un cheminement, des recherches, me font découvrir des artistes passionnants et leur démarche m’apparaît moins obscure même si, je m’intéresse depuis toujours à l’expressionnisme abstrait avec des artistes comme Jackson Pollock, Cy Twombly, Sam Francis, Motherwell, Jasper Johns, Malevitch etc. Oui, toutes ces expos du CAC me procure un certain plaisir : celui de me dire que j'ai encore en moi une jeunesse; je n’ai pas perdu ma capacité à m’enthousiasmer pour des formes d’art qui me paraissaient jusqu’à présent incompréhensibles. La différence, pour moi, de cet art contemporain avec la peinture dite moderne, c’est que pour celle-ci, je n’ai pas besoin d’aller chercher des explications pour la comprendre, rentrer dedans, j’ai l’impression de faire corps avec elle. Et, je ne parle pas de Nicolas de Staël, plus figuratif, que j’aime particulièrement.
Encore un mot sur cette actrice Mary Ann Duganne où on la voit dans deux vidéos à l'exposition; elle est superbe et m'a fait penser à la merveilleuse Gena Rowlands (ci-dessous).

Il est entendu que je n'ai pas dit le quart, le dixième, le centième de ce que représente le travail de Guy Cointet. "Il est mort prématurément, après le bref succès de De toutes les couleurs (1982) jouée en français à Paris au théâtre du Rond Point, alors qu'il élaborait ce qui restera sa dernière pièce, The Bride Groom (1983), inachevée." (Source : Marie de Brugerolle.)



Autoportraits
"Chez Guy de Cointet, les objets fonctionnent comme des phonèmes. Les glissements de la lettre à l’image, entre lisibilité et visibilité sont caractéristiques de son travail. Il joue sans cesse entre abstraction et réalisme en construisant des décors dont les éléments ont à la fois des formes géométriques simples et des fonctions très prosaïques. L’usage des objets comme mots et des mots comme objets est au cœur du travail de Guy de Cointet.
Le passage s’est opéré chez lui du livre à la performance, pour former des dispositifs scéniques dans lesquels la voix, le geste, le mouvement sont complémentaire et indissociables.. Le changement d’échelle sera un des facteurs essentiels : "Je les utilise (les livres) dans mes performances mais sous des formes agrandies que j’ai créées, ainsi le public peut voir exactement ce qui est écrit ou dessiné". […]




La variation de la taille des choses permet d’exacerber la réception du public, les objets deviennent des simulacres : ils ne sont pas la chose qu’ils représentent, ils en ont l’aspect, mais leur taille diverge. Leur artificialité est évidente. Un livre en carton peint n’est pas le substitut d’un livre de papier : il devient un portrait de livre, un personnage-livre, un support de discours.
Pour comprendre les problématiques de l’exposition, il faut situer l’importance de la théâtralité dans l’œuvre de Guy de Cointet.


Mary Ann Duganne
Libellés :
Art,
Autoportrait,
CAC Quimper,
Exposition,
Guy de Cointet,
Peinture
jeudi 17 mars 2011
De Montaigne à... Epicure
Je connais aussi un homme qui ne peut supporter de voir manger ni qu'on le voie manger, et il cherche à éviter toute présence, plus quand il s'emplit que s'il se vide.
Dans l'Empire du Grand Turc on voit un grand nombre d'hommes qui, pour exceller sur les autres, ne se laissent jamais voir quand ils prennent leur repas, qui n'en font qu'un dans la semaine, qui se déchiquettent et se balafrent la face et les membres, qui ne parlent jamais à personne. Ce ne sont là que des fanatiques qui pensent honorer leur nature en se dénaturant, qui s'estiment de se mépriser et croient s'améliorer en se détériorant.
Michel de Montaigne, in Essais.
En écoutant ce texte ce matin, je pensais que finalement, je n'aimais pas trop non plus que l'on me voie manger. Je connais une amie qui m'aurait encore dit ce soir, si elle m'avait vue : "toi, tu es courageuse, tu ne crains pas d'aller toute seule au restaurant". Eh oui! je n'ai pas craint pas de me "montrer en public" en train de "mâcher" et de mettre mes doigts - avec grâce - dans mon chaudron de moules! Il faut reconnaître que le test du restaurant lors d'une rencontre amoureuse peut être fatal!
Ce soir j'ai assisté à une projection vidéo sur un artiste étonnant sur lequel je reviendrai : Guy de Cointet. Il m'a donné faim, il était tard, j'avais envie de mettre les pieds sous la table. Oui, je sais, c'est mieux à deux mais "mieux vaut être seule que..." blablabla! Et puis, dans ma tête je ne suis jamais seule. De plus, la brasserie était pleine, et les moules à l'andouille (je n'invente rien) délicieuses!

Libellés :
Journal,
Montaigne,
Philosophie,
Raphaël Enthoven
mardi 15 mars 2011
Lu Xun
Petit rappel :
LU XUN: L'âme de la Nation
"A travers la destinée de l'écrivain Chinois LU XUN, nous découvrons la vie des lettres et l'apparition des intellectuels modernes au cours des différentes révolutions qui bouleversent la Chine depuis un siècle. Ce portrait de LU XUN s'intègre dans la série "Un Siècle d'Ecrivains" proposée par Bernard RAPP sur FRANCE 3.
Le nom de Lu Xun (1881-1936) est étranger à la plupart d'entre nous, si ce n'est peut-être pour Journal d'un fou, premier texte écrit en langue chinoise parlée, et La Véritable Histoire d’Ah Q (éditions Stock). Pourtant, ce fils de lettres profond érudit, considéré comme le plus grand écrivain de la Chine moderne, abondamment "récupéré" après sa mort par le pouvoir officiel, a non seulement incarné l’avènement de l'intellectuel indépendant dans un pays où les esprits étaient jusqu’alors soumis au système confucéen, mais a impulsé des avant-gardes sociales, politiques, artistiques encore à l'ordre du jour. D'une belle élégance formelle, remarquablement construit et documenté, le film d’Henry Lange (réalisé avec le concours de Zoo Si, à l’appui des témoignages de familiers et des « héritiers» de son œuvre) restitue à la fois le cadre de cette Chine en mutation dans laquelle Lu Xun a évolué; la richesse et la singularité de son parcours; la solitude exigeante de sa pensée et de ses engagements; le mélange inextricable de lucidité pessimiste et d'élans utopistes qui ont animé cet intraitable, jamais dupe des masques pseudo-révolutionnaires de l'asservissement. Traducteur, enseignant, artiste, romancier, conteur ou polémiste, Lu Xun s'est épuisé, à défendre et revendiquer la liberté, la dignité sociale de chacun."
Réalisation Henry LANGE
Coproduction F PRODUCTIONS / FRANCE 3 / BEIJING TV
Droits MONDIAUX Durée : 52 mn
Versions FRANÇAISE, INTERNATIONALE
J’ai capturé sur mon écran ces deux passages:
Le réalisateur
 Pu Cunxin, Lu Xun
Pu Cunxin, Lu Xun La véritable histoire d’Ah Q a également fait l’objet d’un film de Cen Fan "qui, en 1982, fit sensation au Festival de Cannes et l’acteur Yan Shunkaï reçu le prix du meilleur acteur au festival international du film de comédie de Vevey, en août 1982."
 Yan Shunkai
Yan Shunkai
Hier je regardais rapidement aux informations à la télévision des images d’une exposition qui se tient à Paris en ce moment : Tous cannibales, et cela m’a interpellée, je me souvenais des mots de Lu Xun : "dévorer l'homme", (seconde vidéo).
Une phrase de Claude Lévi-Strauss, placée en exergue de l'exposition, donne le ton :
"Nous sommes tous des cannibales. Le moyen le plus simple d’identifier autrui à soi-même, c’est encore de le manger".
"Chez certaines tribus anthropophages, boire le sang et manger la chair de leurs ennemis était un moyen de s'approprier leur force. Le délire anthropophagique est une conviction psychotique : boire le sang de l'homme rapprocherait l'anthropophage du divin. En contact avec les peuples amérindiens, les explorateurs ont cherché à expliquer les motivations des tribus cannibales. Dans son Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, Jean de Léry explique que "plus que par vengeance et pour le goût (…), leur principale intention est, qu'en poursuivant et rongeant ainsi les morts jusqu'aux os, ils donnent par ce moyen crainte et épouvantement aux vivants". L'anthropophagie est généralement considérée comme un acte de folie dans les sociétés occidentales. Il est perçu aussi chez certains peuples comme un acte d'humiliation pour la personne dépecée et sa famille. L'anthropophagie peut également être vue dans certains cas comme une volonté de s'approprier une partie de quelqu'un, à compter que l'anthropophagie ne nécessite pas forcément de meurtre. Ce n'est pas de la démence dans tous les cas de figure, l'anthropophagie peut être aussi nécessaire pour la survie". (Source Wikipédia)
Inscription à :
Articles (Atom)

























